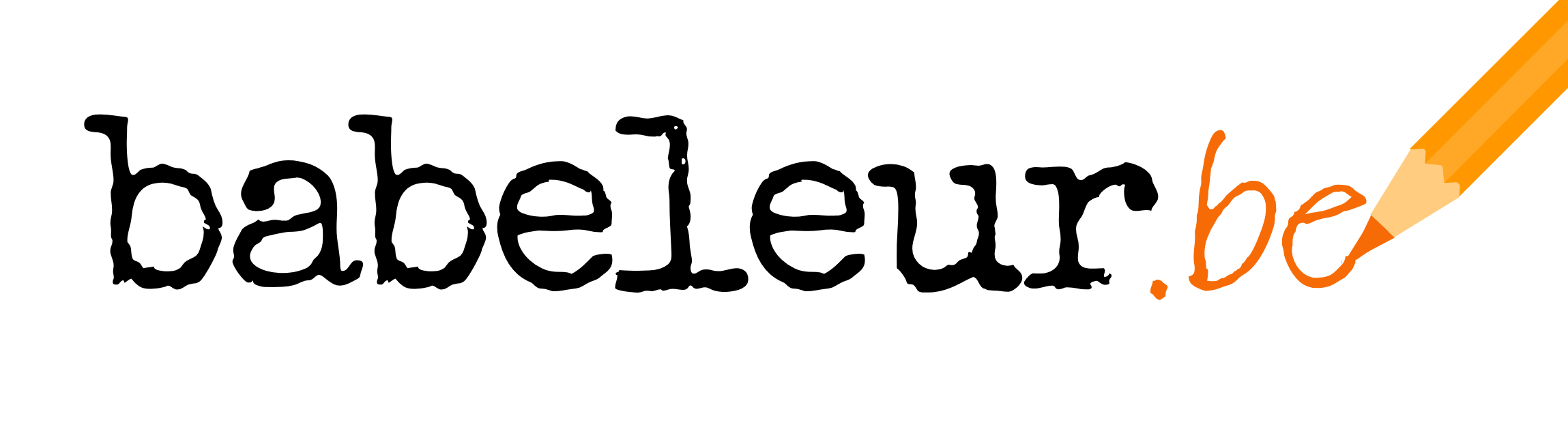Un petit conte normand à l’arrache, écrit pour une répétition avec les copains de 7àDire. C’est une adaptation à la grosse louche d’un très court conte oriental présenté par Jean-Claude Carrière dans Le Cercle des menteurs. Mais pour cette version, il n’est pas impossible que quelques souvenirs authentiques se soient glissés dans la fiction…
Dans mon village natal, en Normandie, on ne peut pas dire que les gars soient causants. C’est pas qu’ils n’aiment pas parler, hein. Ils pourraient, s’ils voulaient. C’est juste qu’on est taiseux par tradition. On a appris que ça ne sert à rien de gaspiller sa salive quand un signe de tête suffit.
Ça fait qu’on se dit bonjour sans se dire bonjour. Quand ton voisin passe, tu hoches la tête sans piper mot. T’as beau connaître le gars depuis 25 ans, avoir été à l’école avec, le croiser tous les jours à l’apéro et en avoir fait le parrain de ton aîné, ça ne te viendrait même pas à l’esprit de lui dire « Eh ! Clément ! Comment que ça va-ti aujourd’hui ? » Alors tu hoches. En silence. En même temps que lui. Il faut que la synchronisation soit parfaite. Sinon, si l’autre bouge une fraction de seconde avant toi, il peut prendre le pouvoir, pour peu qu’il soit un peu sorcier. Et là, c’est grave, parce qu’il peut te faire du malfait — te lancer un sort, si tu préfères. C’est dire si on ne rigole pas avec les « bonjour » !
D’ailleurs, chez Lucien, le patron avait un système pour les habitués. Quand l’un d’eux arrivait, Lucien faisait « hein ? » en levant légèrement le menton. Si le client répondait « hum », c’est qu’il voulait un petit calva. Un « mmm » ? Le gars avait envie d’une bière. Le tarif pour un café, c’était un claquement de doigt. Café-calva ? Deux claquements ! De toute façon, à la longue, la plupart n’avaient plus besoin d’émettre le moindre son : Lucien savait ce qu’ils voulaient, rien qu’à la façon dont la porte grinçait.
Au bout du comptoir, dans ces années-là, il y avait toujours le vieux Léon. Un petit vieux sec comme un coup de trique, avec des yeux qui vous transperçaient et pas un poil dépassant de la casquette. En quarante ans, personne n’avait jamais entendu Léon dire plus de trois mots d’affilée.
C’est dans ce contexte-là qu’on a vu débarquer Régis Busard en 1983. C’était le présentateur vedette du journal de 20 heures, sur la première chaîne couleur. Le genre à porter des lunettes de soleil en permanence, pour pas se laisser éblouir par la blancheur de ses propres dents. Chez nous, ça n’a pas traîné, il est devenu Le Horsain. Sauf pour mon grand-père, qui était horsain, lui aussi — il venait d’Alsace. Et comme Papi préférait la deuxième chaîne, il appelait Busard « Le Con ».

Illustration par IA (OpenArt).
Le Horsain s’était acheté le manoir des Hauts-Vents pour « retrouver son essence profonde » pendant ses week-ends. Du lundi au jeudi, on était tranquilles, il faisait ce qu’il avait à faire à la capitale. Mais chaque vendredi, quand il débarquait, c’était la même comédie : à peine sorti de sa Ferrari 308-GTS, il enfilait ses bottes « L’Aigle » flambant neuves et son jean le plus crade possible — parce qu’il s’imaginait que ça faisait « couleur locale ». Il devait probablement le laisser macérer dans le fumier toute la semaine, son jean, pour obtenir un fumet aussi savoureux.
Et alors, lui, question bavardages, c’était une autre histoire… Dès qu’il vous apercevait, il vous fondait dessus comme un faucon affamé. « Hello ! Je suis Régis, enfin… vous me reconnaissez, évidemment ! Je présente le journal tous les soirs. Je viens de m’installer au manoir, vous savez ? Un vrai coin de paradis ! J’ai tout de suite senti les bonnes énergies telluriques… D’ailleurs, vous qui êtes du cru, vous devez connaître les légendes locales ? La Dame Blanche, par exemple… »
La Dame Blanche, c’était son obsession, au Horsain. Tu connais le principe ? Tu roules de nuit, t’aperçois une auto-stoppeuse dans un virage, tu la fais monter dans ta R12 et pffft ! Au virage d’après, elle a disparu. Y en a partout, des Dames Blanches. Mais le Horsain, il avait entendu parler d’un specimen pas très loin du village. Alors, il emmerdait tout le monde avec ça. Les gens haussaient les épaules, habitués qu’ils étaient à ne pas perdre de temps avec des gars de Paris.
Les week-ends ont passé. Régis s’obstinait à venir au café chaque vendredi soir. Il commandait son petit calva pour tenter de fraterniser avec l’autochtone, et il se lançait dans des monologues interminables devant des clients mutiques. « Lucien, mon ami, je me permets de vous donner un conseil : vous devriez moderniser un peu tout ça. Tenez, si vous installiez une télévision couleur ? Pour que vos clients puissent me regarder en semaine ? » Mais rien n’y faisait. Surtout que tout le monde savait comment ça allait se terminer : « et sinon, la Dame Blanche ? Vous l’avez déjà rencontrée ? » À son bout de comptoir, Léon ne faisait même plus semblant de lever un sourcil de politesse.
Alors un soir, il en a eu marre, Busard. Il a quitté son grand manoir, il a dénoué sa cravate en soie, il est monté dans sa Ferrari et il s’est engagé sur la route qui monte au village. Pour rejoindre le bourg depuis chez lui, il n’y avait que deux routes possibles : la côte du Billot et la côte de Montpinçon. Il s’est dit qu’il avait plus de chances de croiser la Dame Blanche dans la plus sinueuse, alors il a pris celle de Montpinçon.
Il n’avait pas roulé depuis deux minutes quand il l’a aperçue dans ses phares. Une silhouette diaphane au bord de la route, qui lui faisait signe de la main. Il a pilé net, la 308-GTS a fait une embardée et il s’est retrouvé dans le fossé. Un autre soir, il aurait vérifié l’état de sa voiture, mais pas celui-là. Il s’est précipité vers l’apparition. La Dame Blanche se tenait là, dans la nuit d’octobre. Elle flottait à quelques centimètres du sol, dans sa robe vaporeuse.
— Horsain ! Sale Parigot ! Effronté !, elle a tonné d’une voix d’outre-tombe. Tu oses troubler le village ET mon repos, avec tes questions ? Pour la peine, tu vas errer mille ans dans les limbes du temps !
Ni une, ni deux, voilà le Régis projeté dans une dimension parallèle, condamné à voir défiler dix siècles d’histoire comme un spectateur impuissant. Il a fallu qu’il prenne son mal en patience, hein. Il a vu les drakkars remonter les rivières, puis les premiers seigneurs normands s’installer sur leurs mottes féodales. Au début, il a bien tenté de les interviewer. Vous imaginez un témoignage des compagnons de Guillaume partant pour l’Angleterre — l’exclusivité mondiale ! « Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Hastings… ». Mais personne ne le voyait, personne ne l’entendait.
Il a assisté à la construction de l’église du village, il a fui la peste noire, il a observé les bûchers de l’Inquisition et il vu passer les armées anglaises pendant la guerre de Cent Ans. La Révolution, il l’a vécue comme la pire des humiliations : lui, si fin commentateur de la vie politique parisienne, il ne pouvait même pas interroger le plus demeuré des sans-culottes du coin… Puis il s’est ennuyé à périr pendant la Révolution industrielle — vu le peu qu’elle a changé à la vie des vaches de par chez moi. Il a compté les morts de la Première Guerre mondiale et les collabos de la Seconde. Il a vu débarquer les canettes de Coca-Cola et les tracteurs John Deere. Et puis il a assisté à l’exode rural : le village qui se vidait de ses habitants, l’école qui devenait une classe unique avant de fermer, les artisans qui déposaient le bilan. Jusqu’au moment où il n’y a plus eu que le café-épicerie de Lucien, dans le pays. Et alors, Busard a su que sa longue attente avait pris fin. Il y était, bon sang ! Après mille ans de patience, il était enfin sur la bonne route, au bon endroit. Avec sa Ferrari qui fumait dans le fossé.
Les jambes flageolantes, il est monté jusqu’au village pour se précipiter chez Lucien.
— Tiens, v’là Le Con, a dit mon grand-père en sifflant sa bière.
— Du calva, dans un verre à pinte !, a supplié Busard en s’affalant au comptoir. J’ai une histoire incroyable à vous raconter !
Alors il s’est lancé dans le récit de son aventure. Les mille ans d’errance, la solitude infinie, le poids du temps qui passe. Pour la première fois depuis des décennies, tout le monde, dans le café, a cessé de boire pour écouter un horsain parler. Même les mouches s’étaient arrêtées de voler.
C’est là que Léon a pris la parole :
— Attends voir… T’as pris quelle route pour monter ?
— Mais on s’en fout, de la route ! a crié Régis. Je vous parle de mille ans d’errance dans les limbes du temps et vous me demandez quelle route j’ai prise ?
— Ouais. T’as pris laquelle ? La côte du Billot ou la côte de Montpinçon ?
— Celle de Montpinçon…
Léon a hoché la tête, satisfait.
— C’est bien pour toi, mon gars, t’es tombé sur Viviane. Elle n’est pas comme Léonie, la garce qu’est dans la côte du Billot. Celle-là, c’est une vraie peau de vache. T’en aurais pris pour deux mille ans, au moins.
Puis il a replongé dans le silence pour les quarante prochaines années.